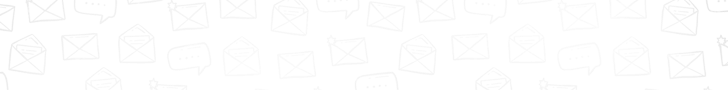C’est en lisant distraitement quelques articles au cours de ce week-end pascal que je suis tombé sur une information qui m’a profondément interpellé : selon plusieurs médias américains, dont The Telegraph, Bloomberg et The New York Times, l’administration Trump envisagerait une profonde restructuration du département d’État, incluant notamment la fermeture de plusieurs ambassades jugées « non essentielles » en Afrique subsaharienne, ainsi que la suppression du Bureau des affaires africaines.
Cette décision n’a pas encore été officialisée, mais elle s’inscrit dans une méthode désormais bien connue des équipes trumpiennes : laisser fuiter des projets radicaux en guise de ballon d’essai, parfois pour jauger les réactions ou préparer le terrain à des décisions plus mesurées. Même si tout cela n’est pas encore gravé dans le marbre, le signal envoyé n’en est pas moins préoccupant.
En tant qu’observateur attentif, je ne peux m’empêcher de m’interroger sur la portée d’un tel projet. À quoi rime le désengagement diplomatique d’une puissance comme les États-Unis sur un continent aussi stratégique que l’Afrique ? Et que pourrait-il impliquer pour les pays africains, déjà confrontés à de multiples vulnérabilités économiques, sécuritaires ou institutionnelles ?
Une rationalisation qui masque une réorientation idéologique
Certains pourraient y voir une simple rationalisation budgétaire ou une volonté de recentrer les moyens. Après tout, le projet de décret prévoit aussi des coupes similaires au Canada, ainsi que la suppression de structures transversales chargées des droits humains, des réfugiés, du climat ou encore des questions de genre. Mais à y regarder de plus près, ce redéploiement s’inscrit dans une vision plus large : celle d’une politique étrangère de plus en plus sélective, parfois même ouvertement transactionnelle.
La volonté de recentrer l’appareil diplomatique américain sur d’autres priorités est en ligne directe avec la philosophie « America First » de Donald Trump. Il s’agit d’un isolationnisme sélectif : les États-Unis ne se retirent pas totalement du monde, mais choisissent désormais où, comment et pourquoi ils s’engagent — souvent en fonction de leurs seuls intérêts sécuritaires, commerciaux ou électoraux.
Dans cette optique, l’Afrique apparaît, aux yeux de cette administration, comme une variable d’ajustement. À l’exception de la lutte antiterroriste et de l’accès à certaines ressources stratégiques (notamment au Sahel ou en Afrique centrale), le continent ne constitue pas une priorité. D’autant que l’influence américaine — comme celle de la France — n’a cessé de reculer ces dernières années, face à l’offensive diplomatique de la Chine, de la Russie, de la Turquie et, de plus en plus, des Émirats arabes unis et de l’Arabie saoudite.
La Turquie, par exemple, a ouvert 43 ambassades africaines en moins de vingt ans, contre à peine une poignée dans les années 1990. Quant à la Chine, une étude du Center for Strategic and International Studies rappelait récemment qu’elle est aujourd’hui le principal partenaire commercial du continent, avec plus de 250 milliards de dollars d’échanges en 2023. Pékin a également investi plus de 155 milliards de dollars en Afrique entre 2000 et 2020, selon le laboratoire de recherche AidData. La Russie, pour sa part, multiplie les accords miniers et sécuritaires tout en devenant militairement active auprès de plusieurs régimes.
Ce retrait diplomatique américain — s’il venait à se concrétiser — devrait donc servir d’électrochoc pour les dirigeants africains. Car si l’Afrique est ainsi considérée comme périphérique dans la stratégie globale de Washington, c’est aussi parce que, collectivement, elle n’a pas su imposer sa propre centralité géopolitique.
L’urgence d’une réforme structurelle politique, économique et diplomatique commune pour l’Afrique
Il serait certes naïf de croire que l’Union africaine ou les organisations sous-régionales comme la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO), la Communauté économique des États de l’Afrique centrale (CEEAC) ou la Communauté de développement de l’Afrique australe (SADC) peuvent, en l’état, tirer un quelconque avantage de ce retrait. Leurs récentes réactions timorées face aux coups d’État, leur manque de moyens propres, leur dépendance aux financements extérieurs — plus de 60 % du budget de l’Union africaine (UA) est financé par des partenaires internationaux, notamment l’Union européenne (UE) — et leur déconnexion croissante des attentes des populations africaines les ont rendues peu crédibles, voire presque décoratives.
Mais c’est précisément là que réside le défi : tirer les leçons de la perte d’influence des puissances occidentales pour repenser nos institutions continentales, les ancrer dans le réel, leur redonner une légitimité populaire, et les sortir de leur fonctionnement technocratique et parfois élitiste.
Ce moment de redéfinition des équilibres diplomatiques mondiaux devrait être saisi comme un levier stratégique par nos États africains. Il rappelle plus que jamais l’urgence de se concerter, de bâtir des stratégies diplomatiques et économiques communes, de réinvestir les institutions régionales et de peser avec plus de cohérence et de force dans le jeu international. Si les États-Unis se retirent, alors c’est à l’Afrique de démontrer qu’elle n’est pas un simple terrain de jeux pour puissances rivales, mais un acteur à part entière, capable de bâtir son autonomie stratégique, diplomatique et politique. Faute de quoi, d’autres occuperont l’espace laissé vacant, selon leurs propres règles et à leur seuls avantages.
Souleymane Camara
Sources :
The New York Times, “Trump eyes closure of US embassies in Africa”
CSIS, China-Africa Trade Tracker, 2023
Fondation Mo Ibrahim, African Governance Report 2023